Ce texte a été préparé pour une séance du séminaire ‘Narrating Europe” organisé par Benoît Majerus pour le Master Histoire européenne contemporaine de l’université du Luxembourg. Le séminaire se penche sur les différents types de narration existant actuellement sur l’histoire de l’Europe, en invitant historiens, muséologues, ‘digital humanists’ travaillant sur l’Europe.
Ce billet est publié simultanément sur Devenir historien-ne et sur h-europe.
Ego Histoire (1) — L’Europe à toutes les sauces
Je crois n’avoir pas cessé d’étudier l’Europe dans le sens “construction européenne” depuis le milieu du collège français, soit depuis que j’ai 13-14 ans. Dans un sens plus large, l’histoire de manière générale est enseignée à l’école dès 6 ans en France, et en particulier l’histoire de l’Europe, même s’il y a réorientation, dans les programmes les plus récents, vers une histoire plus globale1.
Cette enseignement scolaire de l’histoire de l’Europe est associée à un enseignement scolaire géographique de l’Europe – l’association entre histoire et géographie dans l’enseignement primaire et secondaire en France est particulièrement importante.
Ceci est propre à l’enseignement dans toute la France. Au fur et à mesure des années, le programme a été plus précis, jusqu’à celui de Terminale (scientifique mais avec un programme d’histoire géo important), où l’enseignement de l’histoire de l’intégration européenne et de l’Union européenne dans un sens géographie humaine est devenu assez pointu.
À cet enseignement, classique pour un Français, s’ajoute la couche Alsace-Moselle. En France, tout le monde le sait, l’Alsace-Moselle est responsable de trois guerres entre la France et l’Allemagne (1870, Première et Deuxième Guerres mondiales)- c’est complètement faux, mais c’est parfois vécu comme ça. La proximité avec l’Allemagne, un amour-haine constant des Alsaciens pour l’Allemagne et pour la France, donne une résonance particulière à cette région, qui, à chaque élection, oscille entre ouverture vers l’Europe et repli identitaire alsacien ou Français. Bref, si l’Europe – toujours au sens “intégration européenne” – a pu laisser beaucoup de citoyens français indifférents, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui, ça n’a jamais été le cas en Alsace, d’autant plus que Strasbourg, ma ville natale et où j’habite à nouveau, a accueilli plusieurs organisations européennes (Conseil de l’Europe, CEDH, Parlement européen).
En clair, quand je commence mes études de sciences politiques à Strasbourg avec la ferme intention de devenir journaliste politique, je suis très favorable à l’Europe, à l’image de ma ville et de ma région natales.
Ego Histoire (2) – Études et recherches
L’enseignement dans les Instituts d’Études politiques français est partagé entre Droit public (français, européen, international), économie politique, sociologie politique et histoire. Une très grande partie des trois ans d’études ont été consacrées, toujours, à l’intégration européenne, sous ces quatre angles.
Pourtant, ce n’est pas l’intégration européenne qui a été le sujet de mes recherches. J’ai plutôt recherché, toujours en tant que bon Alsacien dont la grand-mère, née allemande, a été réintégrée dans la nationalité française et dont le grand père a fui les troupes allemandes en allant à Alger, à comprendre ce qui s’est passé entre les deux guerres mondiales.
Rencontrant mon futur directeur de thèse, Sylvain Schirmann, j’ai commencé par un mémoire sur la politique économique française de 1936 à 1939, vue par un journal anglais The Economist. Cette orientation histoire des relations internationales économiques de l’Europe s’est confirmée en DEA (Master 2) avec l’étude de la mission van Zeeland. Cela a été suivi d’une thèse sur Hjalmar Schacht, rencontré lors de mes premières recherches: je suis passé tout doucement de la France à l’Allemagne, mais en gardant quelque chose de central. Comment organiser économiquement, financièrement et monétairement le continent européen (ce qui rejoint le cœur des recherches de mon directeur de thèse)?
Ces recherches ont finalement rejoint la question de l’intégration européenne. Bien que n’ayant pas directement étudié la Seconde Guerre mondiale elle-même, ses causes me sont bien familières. Je comprends, ce qui est très classique, l’histoire de l’intégration européenne comme une volonté de paix. Paix politique, mais aussi économique et monétaire – c’est important de s’en souvenir.
Il y a dans les années 1920 et 1930 de nombreuses tentatives de pacifier l’Europe. Elles sont de natures très diverses, ce qui permet de comprendre ce qui peut marcher et ce qui ne peut pas marcher. L’impérialisme, du pauvre (France dans la première moitié des années 1920, Soutou), de la race ou autre, ne peut marcher. Inscrire durablement la revanche dans des plans politiques, économiques, financiers a lamentablement échoué. Vouloir la domination militaire ou raciale a mené à une catastrophe sans précédent. Mais les tentatives d’entente politique ont aussi buté sur un écueil fait d’économie, de monnaie et de finances qui dysfonctionnent.
Du coup, lorsque l’on regarde les tentatives intégratrices (pacifiques) de l’Europe dans les années 1920 et 1930, on s’aperçoit que ce qui a fonctionné a plutôt été dans le domaine économique et, dans une moindre mesure, monétaire. Économique? En fait, industriel: ce sont les cartels internationaux. On citera, puisque l’on est au Luxembourg, celui de l’acier, bien sûr. Dans le domaine monétaire, l’entre-deux-guerres, sans inventer la coopération entre banques centrales, l’institutionnalise fortement: les comités économique et financier de la Société des Nations jouent un rôle important. Puis, la fondation de la Banque des règlements internationaux, à Bâle, est un événement sous-estimé, mais majeur: une fois par an, les banquiers centraux de nombreux pays dans le monde se rencontrent. Un nombre plus restreint discute tous les mois. De nombreuses informations circulent alors. Dans le domaine monétaire, la BRI réussit ce que la SDN n’a que partiellement fait, du moins jusqu’à l’avènement de la Seconde Guerre mondiale.
En parallèle, je mentionnerais quand même – c’est un petit point de comparaison avec les technologies de l’information d’aujourd’hui – que ceci (la BRI, la SDN) n’est possible que par l’expansion de nouveaux moyens de communication matériels (l’avion) et immatériels (la radio et dans une bien moindre mesure la télévision).
Quelles conclusions tirer rapidement de mes recherches sur l’entre-deux-guerres en relation avec la manière dont je “raconte” l’Europe dans mes recherches:
- L’entente entre la France et l’Allemagne doit exister;
- Cette entente ne peut être qu’inclusive, notamment en relation avec le Royaume Uni et l’URSS puis la Russie – sur ce point, il n’y a pas le choix;
- La construction européenne doit permettre d’amener la paix en Europe;
- Elle doit être globale: la construction européenne ne peut être que politique ou qu’économique.
Ego Histoire (3) – 1989-2005
Cette vision de l’Europe, cette manière de la raconter, a vite été troublé. Le récit que je viens de faire n’est en fait pas si linéaire que ça.
1989-2005? Quel est le sens de ces dates? Je crois que 2005 s’explique de lui-même: c’est l’échec du traité constitutionnel européen, par les Français et les Néerlandais. À mon niveau personnel, c’est une réflexion aussi sur le sens de l’intégration européenne.
La paix est un acquis. Expliquer que l’ont fait l’Europe pour la paix n’est plus suffisant. Expliquer que l’Europe, c’est le marché unique n’est plus suffisant. Il y a manque de politique, très certainement – c’est aussi ce qui a manqué à la zone euro depuis 2008. Mais comment combler ce manque politique? Je n’ai pas de réponse à cette question.
La paix est un acquis? Oui, très certainement car nous n’avons plus eu de conflit en Europe occidentale depuis 1945. Certes.
Mais il y a eu 1989. La chute du Mur. Le discours, aussi, de Milosevic à Gazimestan. Célébrant les 600 ans de la bataille du Kosovo perdue par les Serbes contre les Ottomans, Milosevic prononce ouvertement un discours nationaliste serbe, faisant référence à la possibilité de recourir aux armes par la Serbie, alors l’un des États de la Yougoslavie. C’est lors de ce discours que commence, de fait, la guerre de Yougoslavie, traumatisme de l’Europe.
À l’image de la crise de l’euro aujourd’hui, la guerre en ex-Yougoslavie a montré toutes les failles de l’Europe, dans un sens large: l’Union européenne, à peine née (transformée de CEE en UE), est impuissante – ses membres ne lui ont pas donné les moyens de réagir. L’Ex-Yougoslavie montre que si le couple franco-allemand ne fonctionne pas (reconnaissance de la Croatie par l’Allemagne, attitude ambiguë de François Mitterrand vis-à-vis de la Serbie), l’Europe ne fonctionne pas.
1989 est suivi de nombreuses tribulations de l’Europe, qui marque l’entrée de l’intégration européenne dans les opinions publiques européennes. On parle de déficit démocratique de l’Union, à plus ou moins juste titre. On devrait parler de manque de légitimité démocratique. Le traité de Maastricht soulève une très vive et plutôt nouvelle opposition à la construction européenne, telle qu’elle s’est faite, en France (référendum de 1991). Mais aussi dans d’autres pays: Norvège, qui refuse d’entrée pour la seconde fois, Irlande, Pays-Bas, Suède, Royaume-Uni… mais finalement aussi l’Allemagne, même si c’est relativement tabou de le dire.
La période de 1989 à 2005 montre le paradoxe de l’Europe: là où elle a réussi (la paix), elle n’a pas assez réussi (Yougoslavie) et on ne lui donne aucun crédit (mon argument pour 2005: parler du couple franco-allemand ou de la paix n’a plus d’influence dans le débat public lors d’un vote européen). Là où elle a été fondée (l’économie), elle est radicalement remise en cause de tous les côtés (libéraux car trop dirigistes, certaines parties de la droite et de la gauche car ne laisse pas les Nations suffisamment souverainistes). Là où elle essayé de s’implanter dans les années 1990 et 2000, elle est soit face à ses contradictions (l’euro), soit en déroute complète (les Affaires étrangères).
En quoi tout ceci a-t-il influencé mes recherches? En 2008, quand un collègue de Strasbourg, alors que je commençais à travailler au CVCE, à Luxembourg, est venu me parler d’un programme de conférences sur les oppositions à l’Europe dont il fallait chercher le financement, j’ai immédiatement accepté.
Ce thème a été très nettement négligé – sauf autour du rejet de la CED par la France en 1952, et encore – par les historiens. Il est abordé de manière étrange par les juristes (on contourne les oppositions à l’Europe) et a été un peu plus creusé par les sciences politiques.
J’ai ainsi, après une série de conférences, lié le CVCE à ce projet – ce qui nous a permis d’enregistrer tous les séminaires, et m’a permis de co-diriger (et donc de lire dans le plus grand détail les contributions, venues de toute l’Europe) le premier volume issu de ce programme sur les oppositions à l’Europe.
Étudier les oppositions à l’Europe est très intéressant, car il montre ce qui manque à l’Europe. L’année de ce programme sur les oppositions à l’Europe (2008), j’ai également participé à un colloque sur les 50 ans du congrès de La Haye. En 1948, de nombreux européistes se sont rencontrés à La Haye, lors d’un congrès ouvert par Churchill. Le résultat “concret” de ce congrès, c’est la création du Conseil de l’Europe, organisation aujourd’hui assez vide, mais qui a joué un rôle capital dans les Droits de l’Homme (CEDH) et pour l’intégration des pays de l’ancien bloc communiste à l’Europe dans la première moitié des années 1990. Mais lorsque l’on regarde les trois commissions du congrès de La Haye (politique, économique et financière, culturelle), on s’aperçoit qu’un point particulièrement important ressort: la culture.
Dans mon article sur les oppositions à l’euro, ce que je constate, c’est que les économistes, qui pourtant sont censés élaborer des modèles mathématiques “objectifs”, sont d’abord issu d’un pays. Une culture commune leur manque: les économistes allemands estimaient que l’euro ne pourrait marcher car il ne reposait pas assez sur le modèle allemand et les Français pensaient que la monnaie unique serait trop allemande et pas assez française. Aucun n’était capable d’aller voir ce que les autres pensaient.
Finalement, on en revient aux fondations: l’Europe par la culture, celle de Denis de Rougemont. C’est la seule capable – j’entends ici culture dans un sens très large, et surtout avec une connotation d’ouverture sur les autres – de réaliser une réelle unité de l’Europe.
Ego Histoire (4) – L’historien, le citoyen et le numérique
Cette notion d’Europe de la culture questionne, pour l’historien que je suis, les relations du chercheur aux citoyens. Je n’ai pas été, avant 2008, quelqu’un d’intéressé par la vulgarisation. Par la force des choses, j’ai dû l’être, car en tant que chercheur au CVCE, je devais m’y intéresser. C’est finalement, je crois, quelque chose qui est en train de compléter ma formation d’historien.
Comme dans les années 1930, nous sommes à un moment important. Je ne fais pas référence à la crise, mais aux nouveaux moyens de communication, aux technologies de l’information. Elles changent tout: la “société” (sans vouloir réifier cette notion), la politique, l’économie, même la monnaie. Bien entendu aussi la culture elle-même.
Le CVCE comme le projet sur lequel je travaille aujourd’hui essayent d’utiliser le numérique dans une perspective de vulgarisation – aux États Unis, on dirait Public history, ce qui a l’avantage de ne pas porter de connotation négative.
Je vais maintenant m’arrêter sur ce que je fais aujourd’hui, et essayer de le connecter à ce que j’ai dit dans les minutes précédentes. Recruté comme ingénieur de recherche pour un LabEx (un regroupement dit d’excellence (Ex) de laboratoires (Lab) de recherche financé par l’emprunt Sarkozy) “Écrire une histoire nouvelle de l’Europe”. Ce LabEx, dirigé par Éric Bussière (qui a aussi travaillé sur l’organisation économique et financière du continent européen dans l’entre-deux-guerres), a pris pour point de départ le constat que l’historiographie de l’intégration européenne est incapable d’expliquer la crise que traverse l’Union européenne. Cette incapacité doit être résolue par la réintégration de cette historiographie dans l’historiographie plus générale de l’histoire de l’Europe. Lorsque j’ai postulé en avril dernier pour intégrer ce LabEx, je ne pouvais être qu’en accord avec ce constat, ayant interrogé depuis 2005 ma capacité, en tant qu’historien, à répondre aux attentes des citoyens vis-à-vis de l’Europe. L’originalité de ce LabEx est de partir, du coup, des problèmes d’aujourd’hui. Différents outils seront mis en œuvre pour atteindre ce but: les outils les plus traditionnels des chercheurs (livres, colloques, etc) et un outil moins traditionnel pour une université française: une encyclopédie en ligne.
Cette dernière est un aspect important de mon poste actuel. Je ne vais pas l’écrire à proprement parler, mais en élaborer le système d’édition. Conceptuellement parlant, il s’agit de s’adresser à des publics assez variés (professionnels et décideurs – de la politique, du secteur économique et autres-, enseignants, et citoyens “intéressés”), en mettant en valeurs des aspects liés aux problèmes d’aujourd’hui et peu traités ailleurs. Il n’y aura pas – c’est un exemple souvent donné par Éric Bussière – de notice sur Jean Monnet. Les notices – je ne peux encore rentrer dans le détail, dans la mesure où l’encyclopédie est un projet à ses débuts – seront élaborés par les équipes des sept axes du LabEx:
- L’Europe comme produit de la civilisation matérielle;
- L’Europe dans une épistémologie du politique;
- L’humanisme européen ou la construction d’une Europe «pour soi», entre affirmation et crise identitaires;
- L’Europe comme «hors soi»: frontières, voisinage et altérité lointaine;
- L’Europe des guerres et des traces de guerre;
- Genre et identités européennes;
- Traditions nationales, circulations et identités dans l’art européen.
Elles couvriront ainsi des sujets très variés (civilisation matérielle, politique, guerre, art, altérité, identité, genre…). Il me semble que ceci rejoint mon expérience sur ce qui manque en Europe: la considération de l’autre, de son histoire, son identité. Bref, dit un peu rapidement, l’Europe par la culture, celle qui manque aujourd’hui.
Comment assurer la diffusion de cette encyclopédie, de sa logique, auprès d’un large public? Il est important, ici, qu’il s’agisse d’une encyclopédie en ligne. Les encyclopédies qui ne sont pas en ligne, aujourd’hui se meurent. Il n’y a de survie pour ce genre éditorial qu’en ligne, car le réseau, plus particulièrement le web, me semble lui être particulièrement adapté. Nous utiliserons tous les moyens que nous donne le web d’aujourd’hui pour la diffuser et, en ce sens, faire de la public history, intervenir, à une échelle peut être modeste mais bien utile, dans la relation des citoyens à l’Europe: la diffusion sur les réseaux sociaux, la participation au web dit “sémantique” (linked open data) avec la participation – si le conseil scientifique du LabEx l’approuve – de l’encyclopédie à Europeana (ce qui permet une diffusion des méta données sur Europeana, mais leur réexploitation par d’autres projets ce qui potentialise encore plus la bonne diffusion de l’encyclopédie -, l’enrichissement des notices (via Europeana ou la DPLA).
Il existe de nombreux projets dits “Digital Humanities” qui aujourd’hui s’intéressent à un grand public, comme le CVCE au Luxembourg. Toutefois la double préoccupation de recherche très approfondies associant plusieurs centres de recherche de très bon niveau, avec une volonté de vulgariser dans le sens noble du terme sur l’Europe me semble, finalement, plutôt originale.
Avant d’aborder plus dans les détails les éléments plus liés au numérique dans la manière de « raconter l’Europe », je me permets un plus grand détour sur ce que j’ai appris jusqu’ici des relations entre sciences historiques et numérique, sans vouloir être exhaustif.
Comment l’écriture de l’histoire évolue-t-elle avec le numérique ?
L’écriture de l’histoire à l’ère du papier a été très dépendante du livre. Les sciences historiques d’aujourd’hui sont structurées par la publication papier :
Pour le travail quotidien de l’historien :
- Stockage des archives papier ;
- Notes de l’historien prises sur le papier ;
Pour l’écriture historienne :
- écriture d’articles, de livres.
Ceci a pour conséquence que l’historien, même s’il travaille « en réseau » depuis longtemps (ex. des débats franco-allemands sur la « nation » de la deuxième moitié du XIXe siècle ; ex du déploiement académique de l’école économique allemande au tournant des XIXe et XXe siècles), il y a un moment où sa recherche est privée : quand il est dans les centres d’archives et prend des notes, quand il rassemble ses notes, quand il en fait un chapitre, un article ou un livre.
Puis une phase publique s’ouvre, où l’historien ne sera plus seul : il doit compter avec un éditeur et toute la chaîne de l’édition, puis il doit défendre ses hypothèses, son travail devant un public de pairs (colloques), plus rarement devant un public un peu plus large, en règle générale lors de « disputes » comme l’Historikerstreit allemande des années 1980, ou les débats publics sur la collaboration et la résistance en France dans les années 1990 autour de Jean Moulin, François Mitterrand, ou les époux Aubrac. Ces grandes disputes touchent la plupart du temps des éléments douloureux de la mémoire collective.
Avec l’arrivée progressive du numérique dans le monde de la recherche, le processus de « fabrication » de l’histoire évolue grandement.
L’élargissement du champ de recherche des sciences historiques, par l’école des Annales, notamment, a montré à quel point l’information historique est abondante. Dès la fin des années 1950, les historiens se posent la question de la gestion d’une information de plus en plus abondante. Et cette question s’accroît à chaque évolution numérique majeure : le passage à la micro-informatique puis à la mise en réseau qui correspond aussi à une mise en données et une numérisation de l’information sans précédent.
L’informatique et le réseau déstructurent complètement le modèle précédent de fabrication de l’histoire, car ils rendent le livre progressivement caduque. Un livre, un chapitre, un article sont faits pour être lus de la première à la dernière page. Leur structure est maîtrisée depuis la Renaissance (livre) et le XVIIIe (article) et est relativement simple à maîtriser. Les pratiques des lectures sont aussi assez simples à comprendre : lecture intime, lecture linéaire (plus ou moins), pas de médiation entre le lecteur et l’auteur autre que le livre, pas ou peu d’accès aux sources primaires par le lecteur, même s’il y a des notes de bas de page qui, théoriquement, lui permettent d’aller vérifier les sources utilisées par l’auteur.
Écrire l’histoire à l’ère numérique est nettement plus complexe.
- Médiation entre l’auteur et le lecteur : c’est l’un des points les plus compliqués. Il peut ne plus y en avoir du tout (accès direct aux sources primaires numérisées ou nées numériques), il peut y en avoir de nouvelles (usages d’outils d’analyse de texte, par exemple) ;
- Modes de lecture : ils sont infinis, car l’écrit sur le réseau est pluridimensionnel grâce à l’hyperlien conceptualisé par Ted Nelson dans les années 1960 et mis en pratique par le web. La lecture n’est plus que rarement linéaire et est le plus souvent séquentielle ;
- Aux modes de lectures, il faut associer la notion d’annotation. Aussi vieille que le Moyen Âge, l’annotation devient une pratique facile et courante avec le web ;
- Enfin, il y a le commentaire : techniquement, tout ce qui est sur le web peut être commenté, et, ceci, par n’importe qui. La discussion, le débat autour des hypothèses fondant une publication n’est est que plus animée, mais aussi que plus cacophoniques parfois.
Bref, le lecteur numérique est autant acteur de la fabrique de l’histoire que l’historien lui-même.
En conséquence, l’écriture de l’histoire doit se faire aujourd’hui avec en tête les usages des lecteurs, ce qui n’était pas le cas avec l’écriture d’un livre : non pas que l’on ne s’occupe pas du lecteur, mais le livre ne permet pas d’usages aussi variés.
Second point qui bouleverse la fabrique de l’histoire, c’est l’ouverture de l’atelier de l’historien.ne. Les blogs, par exemple sur hypotheses.org (enklask.hypotheses.org / majerus.hypotheses.org), permettent à l’historien d’informer sur les pratiques qui autrefois se faisaient à l’étape privée de la recherche. Cela signifie que le débat sur les hypothèses (et ce n’est pas pour rien que cette plateforme s’appelle hypotheses.org) peut commencer dès le début d’un processus de recherche. Et ce débat peut se faire avec d’autres historiens, mais aussi avec un public plus large, y compris, pour l’histoire contemporaine, avec des acteurs des faits historiques.
Enfin, troisième point qui change les sciences historiques, c’est leur mise en données : mise en données des sources, mises en données des résultats de la recherche, des débats… Les sources primaires et secondaires peuvent être lues via des instruments d’analyse de texte, fouille de données, visualisation des données, etc. Cela permet, justement, de gérer une abondance d’informations sans précédent. Cela permet également, de (potentiellement) connecter tout ce que font et qu’utilisent les historiens. Cela signifie aussi, grand débat en cours, que les sources utilisées par les chercheurs et mises en données doivent être pensées comme des bases de données que tout le monde peut réutiliser.
Quelles sont les conséquences pour la manière de raconter l’Europe ? Je reviens ici à ma propre expérience.
Dans le cas de l’encyclopédie que le LabEx EHNE est en train de construire, cela signifie que nous tenterons, à côté de l’écriture, sur un mode plutôt classique, des notices, de jouer avec l’hyperlien, au bénéfice des lecteurs. Concrètement, qu’est-ce que cela signifie ? Avec ce que l’on appelle le Linked Open Data (la capacité technique de lier des données publiées sur le web entre elles), nous pourront enrichir les notices, en faisant appel au contenu d’Europeana, de la Digital Public Library of America. Cet enrichissement, nous allons tenter même de l’automatiser, bien qu’il faille certainement faire des tests. Si les notices n’auront pas nécessairement d’hyperliens classiques en leur sein (mais ce sera possible), elles seront enrichies par l’ajout automatique de sources primaires, incitant le lecteur à aller plus loin s’il le désire. Cet enrichissement rentre dans le cadre de l’hypertexte décrit par Nelson.
Qu’est-ce que cela signifie pour l’auteur de la notice ? Qu’il doit lâcher prise, un peu. Qu’il doit renoncer à maîtriser le processus de lecture de son public. C’est difficile, mais c’est la règle du web et du réseau. Le réseau favorise le consensus et non l’autorité (cf. les pages de débat de Wikipédia). Il sera nécessaire pour l’historien de se priver un peu de son autorité s’il souhaite participer à l’élaboration de ce consensus. Le risque, s’il ne le fait pas, est de se couper d’un public plus large et d’agrandir encore l’immense fossé qui peut exister entre le grand public et le monde académique sur l’histoire et ses usages publics (cf. Métronome de Lorant Deutsch / Le film La Chute, etc).
Cet enrichissement sera à double sens. Nous essaierons de faire en sorte que les métadonnées de l’encyclopédie (les données sur les données, celles qui décrivent les notices) soit « moissonnées » par Europeana ou le moteur de recherche en sciences humaines et sociales Isidore. Que les lecteurs puissent, d’un clic, insérer nos notices dans leurs gestionnaires bibliographiques (Zotero, Mendeley, etc). En conséquence, ces métadonnées seront disponibles pour d’autres travaux. Elles pourront enrichir ces autres travaux et de fait les relier à l’encyclopédie, pour la densifier.
Cet enrichissement n’est pas que sur un mode texte : images, vidéos, cartes géographiques sont possibles.
Là-aussi, l’historien doit un peu desserrer son emprise sur son œuvre et, plus qu’à l’ère du livre où c’était déjà possible, accepter que ses écrits puissent être réutilisés à des fins qu’il ne souhaite pas nécessairement. Mais, c’est, là-aussi, la seule manière de se fondre dans le moule du web et du débat qu’il favorise autour de tous les sujets.
Dans le flux d’informations qui peuvent circuler, l’encyclopédie est aussi un moyen de guider le lecteur, de lui proposer de trier l’information, trop abondante. De le rediriger vers les sources et écrits les plus pertinents lorsqu’il veut se documenter sur une question européenne précise.
Dans le cas du CVCE, ce qui était ena.lu et est maintenant disponible sur cvce.eu, il s’agissait de faire un tri des sources primaires, la plupart du temps, à destination d’un grand public. Le problème ici est la contradiction entre ce que souhaite le grand public, les étudiants/enseignants, et les chercheurs. Ces derniers n’ont pas besoin que l’on sélectionne les sources pour eux. Ils ont besoin de beaucoup plus de sources primaires.
D’où l’émergence de différentes « publications » : des corpus de recherche, ensembles documentaires répondant théoriquement aux besoins des chercheurs sur un sujet précis, et des dossiers thématiques, avec des documents exemplaires d’une question donnés à titre d’exemple et un texte synthétisant les connaissances sur cette question.
Le problème est la viabilité d’un tel modèle d’écriture de l’histoire de l’Europe. Non pas que ces modes de publication soient mauvais. En fait le diable est dans les détails. Les chercheurs en histoire voudront non seulement de nombreuses sources primaires, mais également pouvoir eux-mêmes les trier et qu’ils soient compatibles avec leur mode de travail : la fouille de données, l’annotation, l’utilisation facile de leur écrits. Les corpus publiés par le CVCE ne le permettent pas encore suffisamment (albums). D’autres systèmes le permettent, comme l’Old Bailey on-line.
*
Pour conclure, il reste aujourd’hui encore de nombreuses incertitudes sur la manière de raconter l’Europe – et de manière plus générale de faire de l’histoire. Nombreuses sont les pistes explorées, rares sont celles qui seront vouées au succès.
Pour ma part, et pour revenir à la manière dont un chercheur (qu’il travaille sur l’Europe ou non) doit traiter de son sujet, je dois continuer à trouver un compromis entre ce que je publie sur un mode traditionnel et qui est institutionnellement requis et ce que je publie strictement dans la sphère numérique, la plupart du temps sur mon site web.
Sur ce dernier, j’essaye de publier les données que j’ai utilisées pour écrire un billet, je vais essayer, de plus en plus, d’enrichir mes billets sur le même mode que celui que j’ai décrit pour l’encyclopédie.
En résumé, raconter l’Europe aujourd’hui, implique :
- de permettre aux lecteurs d’être actif, donc de moins maîtriser l’ensemble du processus de fabrication de l’histoire ;
- de profiter des possibilités du web pour enrichir ses écrits ;
- de tenir compte de la notion d’hyperlien, de ne pas oublier que la lecture est aujourd’hui essentiellement séquentielle et non plus majoritairement linéaire.
Les avantages de ces modes d’écriture sont de multiplier les contacts avec les lecteurs. Si l’on accepte le parfois très rude exercice de s’exposer au public, notre narration de l’histoire n’en sera que plus proche du grand public, sans compromis sur ses fondations scientifiques. Le risque est, par contre, la cacophonie et l’usage d’un contenu à des fins obscures.
Mais la cacophonie, que l’on soit dans le réel ou sur le réseau, aujourd’hui, pour l’Europe est la règle. Et le numérique, bien compris, bien utilisé peut aussi être un remède à cette cacophonie. D’une certaine manière, c’est ce qu’essaiera de faire l’encyclopédie EHNE : utiliser le numérique pour combler (à son niveau) le fossé entre les historiens, les acteurs de la construction européenne et des citoyens souvent perdus.
- et d’ailleurs contestée: voir l’article de Pierre Nora dans Le Débat consacré au Difficile enseignement de l’histoire. [↩]
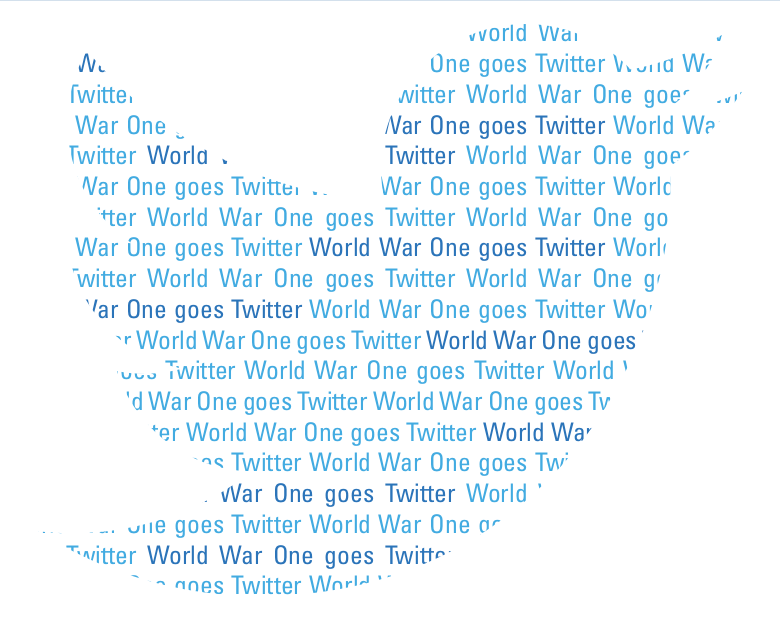 On the occasion of the First World War commemorations, Masters of Modern European History students at the University of Luxembourg are using Twitter to recount, day after day, the twists and turns of the conflict via the @RealTimeWW1 account.
On the occasion of the First World War commemorations, Masters of Modern European History students at the University of Luxembourg are using Twitter to recount, day after day, the twists and turns of the conflict via the @RealTimeWW1 account.





